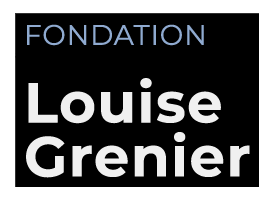Entrevue avec Camille Chalmers: Pour une alternative politique globale post-capitaliste

Voici une retranscription partielle d’une entrevue accordée par Monsieur Camille Chalmers au journaliste Robert Bénodin dans le cadre de l’émission Actualités Politiques diffusée sur les ondes de Radio Classique Inter à la fin du mois d’octobre 2008. Monsieur Chalmers est économiste, écosociologue et Directeur exécutif de la PAPDA (Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour une Développement Alternatif). L’intégralité de l’entrevue est disponible sur le site de la PAPDA à l’adresse suivante : http://www.papda.org/article.php3?id_article=486
Interrogé sur les origines de la crise financière et de la récession mondiale qui sont à nos portes, Monsieur Chalmers explique que nous ne faisons pas seulement face à une crise économique et financière, mais que nous sommes en présence d’une crise beaucoup plus globale de tout le système capitaliste, une crise liée aux contradictions mêmes du système capitaliste. C’est toute la globalisation néolibérale qui est aujourd’hui en crise.
Ainsi, tout ce qui a été prescrit par les responsables des États et par les responsables des grandes firmes multinationales au cours des 20 dernières années, notamment la non-intervention de l’État et la dérégulation dans le domaine financier est aujourd’hui remis en cause. Au cours des 30 dernières années, nous avons assisté à une accélération du processus de financiarisation. Ce processus consiste à rechercher un profit maximal grâce à des masses de capitaux, sans toutefois tenir compte du véritable rythme de croissance de l’économie réelle, c’est-à-dire du cycle de production des richesses matérielles. Les capitaux sont principalement investis dans la spéculation financière ce qui créé un découplage entre l’économie réelle et la sphère financière. Alors que les entreprises transnationales enregistrent des profits variant de 15 à 45%, le taux de création de richesse lui, ne croît qu’à un rythme de 3 ou 4 %. L’économie croît donc à un rythme nettement plus lent que la croissance des profits. C’est ce processus de financiarisation qui mène tout droit à des catastrophes pourtant prévisibles. La crise a une double dimension.
- 1. Une première dimension fonctionnelleparce que le système ne fonctionne plus, nous faisons face à une crise de confiance dans les marchés boursiers.
- 2. Ensuite, une dimension structurelle. Le processus de financiarisation est la méthode trouvée par les capitalistes dans les années 70 pour contrecarrer la tendance à la réduction des taux de profits survenue alors et pour permettre aux grandes entreprises transnationales de continuer à engranger des profits considérables, indépendamment du rythme de croissance réel de l’économie.
La situation risque donc d’être de plus en plus difficile, puisqu’au lieu de changer de paradigme et d’essayer de contrôler les finances, on ne fait qu’appliquer des mesures temporaires qui permettront au système actuel de continuer de fonctionner. Or pour contrer la crise que nous traversons, il faudrait plutôt changer de logique et mettre en place un système économique plus rationnel qui tienne compte de la réalité des masses dans les pays du sud. Il faudrait penser un système qui mettrait les surprofits engrangés de façon scandaleuse par les grandes firmes au service de l’humanité, des salariés, du domaine de la santé publique, de l’éducation, de la reforestation et de tous les problèmes sociaux qui affectent l’humanité, particulièrement dans les pays du sud. Un des grands scandales de la mondialisation néolibérale consiste justement en ce que le pouvoir d’achat de la grande masse des salariés a été bloqué ou a connu une régression. Les salaires ont pratiquement été bloqués depuis les années 90 pendant que, parallèlement à cela, la rémunération des capitalistes a atteint des sommets inégalés. Nous avons appris récemment que plus de 36 milliards de dollars américains avaient été redistribués en primes. Certaines personnes ont reçu en deux ans des sommes avoisinant les 200 millions de dollars. La richesse créée par les travailleurs est donc dirigée vers cette spéculation financière, ce qui est absolument inacceptable.
QUELS SONT LES INSTRUMENTS UTILISÉS DANS LA SPÉCULATION ?
Afin d’assurer une croissance toujours plus importante des profits, on a multiplié les innovations financières et inventé toutes sortes de produits dérivés, qui ne sont en fait rien de plus que des mécanismes financiers permettant d’augmenter considérablement les profits à partir de richesses créées. Avec les subprimes par exemple, on a donné du crédit à des millions de familles, sachant pertinemment qu’elles seraient incapables de rembourser les sommes empruntées. Ces produits ont ensuite été revendus à d’autres banques, puis vendus plusieurs fois dans différents circuits financiers, manipulés par des compagnies d’assurance, pour finalement aboutir à des biens dont la valeur n’avait plus aucune commune mesure avec la valeur initiale et réelle des biens vendus.
Tout cela s’inscrit par ailleurs dans un contexte d’endettement général. L’économie américaine connaît une crise fondamentale de surendettement : endettement des ménages, des entreprises, de l’État, de même qu’un endettement par rapport au reste du monde. C’est précisément cette stratégie qui est en crise et qui risque d’entraîner une rupture fondamentale de l’économie mondiale. Cette stratégie présage d’un processus qui mènera tout droit vers le déclin de l’hégémonie économique américaine d’ici 20 ou 25 ans. Pourquoi? Parce que pour la première fois, la crise financière se situe au cœur même du système capitaliste. Avec les crises que nous avons connues précédemment, qu’il s’agisse de la crise asiatique, de la crise du Brésil, du Mexique ou de l’Argentine, on était en présence de crises en périphérie du système capitaliste. Seule la crise du Japon présageait déjà de la faiblesse des mécanismes financiers des pays du Nord. Mais aujourd’hui, alors que les pays investissent massivement dans les produits financiers américains, nous nous heurtons à une crise de confiance vis-à-vis de ces produits, ce qui se traduira par un changement radical au niveau des flux de capitaux.
DÉCLOISONNEMENT ENTRE LES BANQUES COMMERCIALES, LES BANQUES D’INVESTISSEMENT ET LES ASSURANCES.
La séparation entre les banques d’investissement et les banques commerciales n’a pas été un facteur décisif dans la crise. Grâce à la dérégulation et à l’hégémonie de l’idéologie néolibérale, les opérateurs financiers ont eu la voie libre pour agir avec irrégularité, en violant un ensemble de lois et de principes de précautions jusqu’à se retrouver dans la délinquance financière. D’ailleurs, une des principales caractéristiques de la globalisation néolibérale est l’expansion considérable de l’économie criminelle : paradis fiscaux, trafics illicites de drogue, d’armes, de personnes, contrefaçon de marchandises, etc. Grâce à la dérégulation, et sous prétexte que le marché financier fonctionne mieux lorsqu’aucune règle ne lui est appliquée et lorsque l’État n’intervient pas pour assurer le respect des normes fondamentales de fonctionnement du système, on a favorisé l’expansion de cette économie criminelle. Et aujourd’hui, c’est aux familles pauvres et aux salariés qu’il revient d’assumer les coûts de cette financiarisation débridée. Cela donnera lieu à un transfert rapide de la crise financière à la sphère de l’économie réelle, qui se traduira par une très forte récession de l’économie américaine, des taux de chômage importants et des réductions de programmes sociaux. Sous prétexte qu’il faut se serrer les coudes, les entreprises vont imposer une baisse des salaires et ce sont les masses opprimées, surexploitées qui feront les frais de cette crise et qui payeront les conséquences d’une financiarisation débridée.
DOIT-ON JUGER LES CEO QUI SE SONT ENRICHIS EN SPÉCULANT SUR CES INSTRUMENTS FINANCIERS ?
Il faut juger les CEO pour l’utilisation fantaisiste qu’ils ont faite de l’épargne nationale aux États-Unis. Même en Europe, où le système de régulation est plus rigide qu’aux États-Unis, la même tendance se dessine. Il a d’abord été question de sévir en menant une investigation de recherche du FBI en criminalité financière, puis cette voie a été rapidement circonscrite. Les paradis fiscaux n’ont pas été inquiétés, seuls quelques responsables des différentes pertes considérables ont dû rendre compte de leurs actions lors d’auditions du Congrès américain, et aucun réel mécanisme n’a été mis en place pour freiner cette spéculation irresponsable.
Il faut repenser toute la question de la finance mondiale et du rapport de l’État à l’activité de spéculation financière. Il faut revoir le rôle de la finance et adopter des réformes plus radicales que celles envisagées aujourd’hui. On ne peut pas maintenir les structures intactes en mettant en place de simples plans de sauvetage, car la solution ne se trouve pas à l’intérieur du système. Si nous ne changeons pas substantiellement le fonctionnement de l’économie mondiale, nous sommes voués à revivre une crise similaire dans quelques années. Nous assistons aujourd’hui à la disparition d’une variété de banques d’investissement et avec elles, d’une certaine conception des affaires. Les salaires des dirigeants d’entreprises sont parfois 500 à 600 fois plus élevés que ceux des ouvriers moyens. Or il faut justement mettre en place des mécanismes pour protéger ces petits salariés et les pensionnaires et ainsi éviter que nous avancions vers une régression sociale marquée par le chômage, la récession, etc. Car dans ce type de crise, les réponses politiques précipitent parfois la régression sociale plutôt qu’elles n’abordent les vrais problèmes. Si les Hedges Funds n’ont pas encore subi de grande crise, il n’en faut pas moins lutter contre les fonds vautours, les fonds de pension qui étaient imbriqués dans ces mécanismes financiers irresponsables, car ces fonds ne sont pas à l’abri d’une dévaluation rapide, et des gens qui ont passé leur vie à payer ne pourront pas récupérer le pouvoir d’achat des dix ou quinze dernières années de leur vie.
LES MINISTRES DES FINANCES DU G7 ONT FAVORISÉ L’APPROCHE BRITANNIQUE DE RECAPITALISATION DES BANQUES PAR L’ACHAT DE « PREFERED STOCKS» PLUTÔT QUE L’ACHAT DES SUBPRIMES. CECI A PERMIS UNE REPRISE DU MARCHÉ DE LA BOURSE AUX ÉTATS-UNIS. POURQUOI AVOIR FAVORISÉ CETTE APPROCHE?
L’approche britannique était en fait une approche plus globale. Un des grands problèmes provoqués par la crise était celui de la disponibilité du crédit interbancaire. Ce crédit interbancaire est une sorte de garantie qui permet aux grandes banques de se prêter de l’argent entre elles. Alors que l’achat des subprimes aurait représenté une réponse sectorielle, la recapitalisation des banques a permis une reprise des activités bancaires même sans l’assainissement global des stocks et des fonds.
Ce qui a enrayé le système, c’est le transfert de dettes vers des marchés dérivés et la création de titres à partir de dettes toxiques. Les pays pauvres font face à ce même problème avec leur dette. Les États-Unis ont vendu la quasi-totalité de la dette contractée avec les pays du Tiers-Monde. Les pays africains ont vu le volume de leur dette tripler et même quadrupler à cause de certaines opérations de fonds vautours. Certains pays ont même entrepris une action en justice à cet égard. C’est ce même mécanisme, qui permet une valorisation virtuelle sans commune mesure avec les actifs réels ou les transactions financières initiales qu’il faut absolument revoir. Les différentes banques sont en train d’effacer avec une facilité déconcertante des dettes qui représentent plusieurs fois la dette des pays du Tiers-monde, alors qu’à ce jour, on se refuse encore à effacer la dette du Tiers-Monde, ce qui permettrait pourtant de transformer les relations de domination de l’économie mondiale.
À QUAND REMONTE LA CRISE ?
Le premier signal de la crise a été le krach boursier de 1987. Puis il y a eu la crise au niveau des pays du Tiers-Monde, la crise asiatique, la crise de l’économie japonaise, intimement liée à la question immobilière. S’il est vrai que les décisions d’Allan Greenspan consistant à réduire les taux d’intérêts pour faciliter l’accès au crédit et accroître la consommation et la production ont favorisé à leur façon la spéculation financière, elles ne sont pas à l’origine du problème. Plusieurs économistes avaient déjà prédit la dimension de cette crise en dénonçant la financiarisation débridée à la base même du système. Les réactions de Greenspan n’étaient qu’une tentative visant à réduire les effets de la crise sur le marché global.
LES CRISES QUI SE SUCCÈDENT SONT-ELLES L’EFFET CYCLIQUE ET NATUREL DU FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME ?
Nikolai Kondratieff a étudié les cycles longs du système capitaliste et a établi qu’un cycle durait 30 ans. Il a expliqué que la financiarisation débridée pouvait mener à une crise semblable à celle que nous connaissons aujourd’hui. Il existe des cycles à l’intérieur du système capitaliste, mais les crises qui surviennent diffèrent structurellement, bien qu’elles se répètent avec régularité. Alors que nous étions habitués à un impérialisme exportateur de capitaux, nous sommes aujourd’hui en présence d’un impérialisme qui achète plus de l’étranger qu’il n’exporte. Les gens qui achètent des produits américains ont une quantité importante de dollars qu’ils ne peuvent que réinvestir par l’achat d’autres produits financiers américains. C’est ce qu’ils feront tant et aussi longtemps qu’ils auront confiance dans le système. Dès lors que cette confiance sera ébranlée, comme c’est le cas aujourd’hui, ces investisseurs d’autres pays ne sauront plus que faire de leurs dollars. Cela explique l’affaiblissement du dollar et la crise monétaire qui accompagne la crise financière. Il y aura des crises monétaires plus importantes encore. Les détenteurs de dollars voudront investir en euro ou dans d’autres monnaies. Cela ne signifie pas la fin du système capitaliste pour autant, tel que l’a prédit Immanuel Wallerstein, car ce système a encore des ressorts, et saura prolonger l’agonie encore longtemps.
L’histoire démontre que ces crises ne se transforment pas en alternative politique globale. Pour qu’il y ait émergence d’une alternative politique globale anticapitaliste ou post-capitaliste, il faut des acteurs, des mouvements sociaux conscients de la nature de cette crise qui puissent proposer des alternatives adéquates pour dépasser le système. Or, mises à part quelques niches importantes qui se développent en Amérique latine, aucun mouvement ayant une telle conscience anticapitaliste claire n’existe encore au niveau mondial, et ce, malgré l’ampleur de la crise. La crise de l’environnement a été attribuée à juste titre à la surconsommation et au gaspillage liés à la globalisation néolibérale. L’opinion publique a pris conscience des effets de cette consommation à outrance, mais cette prise de conscience se limite au domaine environnemental. Il n’existe pas encore de mouvement social et politique qui ait conscience de la nécessité de changer de système et d’introduire des nouvelles modalités de fonctionnement du système financier mondial.
COMMENT EXPLIQUER QUE L’EFFONDREMENT DU SECTEUR FINANCIER AIT EU UNE TELLE INFLUENCE SUR L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE ALORS QUE LE SECTEUR FINANCIER NE REPRÉSENTE QUE 4% DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT DES ÉTATS-UNIS ?
C’est le découplage entre l’économie réelle et la sphère financière qui explique cela. Nous vivons une crise de l’hégémonie du capitalisme financier. L’ordre normal des choses à été inversé par le processus de financiarisation et c’est là la maladie fondamentale du système capitaliste. Aujourd’hui, c’est le système financier qui contrôle les autres secteurs d’accumulation, qui donne des ordres au secteur industriel, qui contrôle et qui dicte les relations entre le secteur industriel et le secteur commercial. On assiste à la fin d’une des utopies du capitalisme qui rêvait de faire de l’accumulation financière sans avoir à passer par l’économie réelle, quitte à trouver n’importe quel subterfuge, n’importe quel mécanisme permettant d’enregistrer des surprofits considérables tels que ceux accumulés ces dernières années. Les chiffres démontrent d’ailleurs clairement la domination financière en relation à d’autres sphères de réalisation. On se retrouve avec une économie réelle qui devient un appendice des décisions prises au niveau financier. En réalité les choses devraient être inversées. On demande aux gestionnaires de maximiser le cours en bourse de leur entreprise, quel que soit le coût réel de cette optimisation pour la collectivité et pour l’ensemble de l’économie. Les priorités ont changé. On ne demande plus aux managers de fournir des résultats en termes de création de richesse. Le résultat en bien-être social global, en résolution de problèmes sociaux est relégué au second plan. Il faut revoir la place du secteur financier dans l’ordonnance des rapports de forces à l’intérieur du capitalisme.
Y’A-T-IL LIEU DE PENSER À UN CHANGEMENT PARADIGMATIQUE? QUELLES SONT LES OPTIONS À CONSIDÉRER? Y’A-T-IL UN ESSAI DE MODÉLISATION ?
J’abonde dans le sens du Journal le Monde qui écrit que malgré la mobilisation de l’Union Européenne et l’approbation du plan de sauvetage, le chemin à parcourir reste incertain car si les fonds d’urgence permettent d’éteindre certains feux, ils ne disent rien sur ce qui sera bâti sur ces cendres. Les États sont aujourd’hui préoccupés par la question du sauvetage des banques transnationales. Il faut « sauver le capitalisme des capitalistes » car c’est la rapacité des capitalistes qui est à l’origine de la crise. Tant que des réformes structurelles n’auront pas été introduites dans le système, que les rapports entre capitalisme financier et capitalisme industriel n’auront pas été modifiés, qu’un ensemble de régulations sur l’activité financière elle-même n’auront pas été introduites et que nous n’auront pas mis un frein aux parachutes dorés accordés aux chefs d’entreprises qui engrangent des surprofits, la donne restera la même. Au lieu de bloquer les salaires comme cela a été fait durant les trente dernières années sous l’égide du néolibéralisme, il faut bloquer les dividendes, contrôler les profits, taxer les transactions financières internationales, brider la finance. Certains auteurs proposent d’éliminer la plupart des activités financières actuelles pour ramener la finance à des activités plus frontales telles que les questions humanitaires, les questions d’éducation, de santé publique, etc. Les dirigeants des États des pays du centre, formés à l’école du néolibéralisme et des capitalistes ne sont pas prêts à penser ce système post-capitaliste où les richesses seraient mises au service de l’humanité au lieu d’être privatisées et accaparées par l’intérêt de quelques individus. Il faut proposer un autre paradigme, un nouvel ordre des priorités au niveau de la société pour désarmer la finance et redonner sa juste place à l’économie, un peu à l’instar de ce que préconisait Karl Polanyi en demandant le décentrage de l’économie en relation aux autres sphères de la société.
La FAO a demandé en juin 2008 une somme de 12,3 milliards de dollars américains pour faire face à la crise alimentaire vécue par une trentaine de pays. Entre les mois de juin et d’octobre 2008, elle n’a reçu qu’un milliard de dollars. Parallèlement à cela, une somme de 700 milliards de dollars a été débloquée en un temps record dans le cadre du plan de sauvetage aux États-Unis. C’est cet agenda insensé et obscène qu’il importe de revoir afin de prioriser les besoins des peuples, les besoins de développement. Ce sont les 12,3 milliards de la FAO qu’il faut financer en priorité, mais les dirigeants de pays du centre ne sont pas prêts à faire le saut idéologique nécessaire pour imaginer un système qui fonctionnerait sur d’autres types de valeurs et de régulations et qui ne prioriserait pas les profits des grandes firmes transnationales.
A-T-ON RAISON DE COMPARER CETTE CRISE AU KRACH DE WALL-STREET DE 1929 OU EST-CE ALARMISTE ?
Bien que la crise financière soit profonde, nous n’en sommes pas à l’effondrement de la production vécu après 1929, un effondrement qui atteignait alors 35 à 40% de la production. Nous vivons une crise de confiance, une crise de fonctionnement du système qui pourrait apporter son lot de problèmes structurels décisifs, mais le système dispose encore de ressources pour éviter une récession aussi profonde. Aujourd’hui, la situation diffère de celle des années 30 car nous sommes dans une période d’incertitude où des acteurs importants, susceptibles de jouer un rôle non négligeable ne se sont pas encore prononcés. C’est le cas de la Chine, de l’Inde, du Brésil, de l’Afrique du Sud ou même de certains acteurs au niveau de l’Union Européenne et de l’économie américaine. Des acteurs nouveaux peu connus dans la grande finance internationale pourraient jouer un rôle significatif. La réponse offerte à la crise ne pourra pas être la même que celle apportée par Roosevelt dans les années 30, car l’État américain est aujourd’hui surendetté et ne dispose pas des mêmes moyens financiers. L’intervention des 700 milliards de dollars n’a fait qu’accroître ce déficit. Par ailleurs, le capitalisme industriel transnationalisé est beaucoup plus solide aujourd’hui qu’alors et l’expansion du capital transnational reste encore possible avec l’intégration des marchés comme la Chine et l’Inde à la société de consommation de masse, avec la domination des moyens de communication et avec la tiersmondialisation des pays de l’Europe de l’est.
L’effondrement de l’hégémonie américaine et la crise qui l’accompagne sera difficile à gérer pour les capitalistes mais permettra à de nouveaux acteurs très puissants d’émerger sur la scène internationale. L’Union européenne est déjà classée au premier rang des producteurs de services et de biens industriels. Hugo Chavez a lancé l’idée extrêmement intéressante de créer une banque du Sud. Cela laissera place à un capitalisme très différent avec un puissant processus de régionalisation.
LES ÉTATS-UNIS SONT-ILS RESPONSABLES DE CETTE CRISE ?
Les modèles économiques et financiers américain et européen diffèrent en bien des points. Ce sont des formations sociales différentes, dont les rapports entre les classes diffèrent et qui ont connu une évolution historique qui leur est propre. Ces systèmes capitalistes ont géré différemment l’hégémonie libérale, grâce à de puissants mouvements sociaux. Le niveau de dérégulation n’est pas le même aux États-Unis qu’en Europe. Le modèle social européen a permis de limiter les dégâts du néolibéralisme en France et dans d’autres pays, notamment par les luttes sociales menées en 1995 pour préserver les acquis sociaux des travailleurs et des couches moyennes de la population. Par le biais de luttes sociales, on a maintenu la libéralisation débridée dans des limites différentes de celles des États-Unis. L’Europe a également limité la destruction des règles du contrôle étatique sur le système bancaire et le système financier. Mais il ne faut pas pour autant conclure à une forme de capitalisme plus viable que le modèle nord-américain. Les mouvements sociaux qui ont permis de limiter les dégâts du libéralisme on été vus d’un très mauvais œil par les capitalistes européens qui y ont vu un obstacle a des gains considérables. Par ailleurs, les marchés capitalistes européens et américains sont très imbriqués et sont interdépendants. Là où l’Europe est mieux armée que les États-Unis, c’est que l’État reste un levier très important qui a conservé en partie ses capacités d’intervention. On l’a vu lorsque les États européens sont intervenus récemment en achetant et en nationalisant certaines banques.
Cette crise doit mener à la mise sur pied d’alternatives, à la construction de nouveaux systèmes post-capitalistes qui permettraient que les dogmes de la libéralisation, les accords de libre-échange et l’orientation imposée par l’OMC soient révisés. Des systèmes qui favoriseraient un contrôle de capitaux minimal, qui permettraient qu’un minimum de puissance publique puisse intervenir dans la sphère financière afin d’éviter un gaspillage des ressources de l’humanité. Il faut un système libérateur, débarrassé de la domination capitaliste financière et fort probablement inspiré de l’expérience socialiste. Un système au sein duquel l’Homme, les besoins des individus, le bonheur des individus et l’épanouissement des pays occupent une importance centrale.
FIN DU LEADERSHIP AMÉRCAIN
Même si les États-Unis resteront un pays important, ils ne joueront plus un rôle central au niveau des circuits financiers du secteur économique. Certaines puissances renforceront leur rôle, de nouvelles puissance émergeront, il reste juste à savoir lesquelles. Le cœur de la finance mondiale se déplacera.
LA FIN DU CAPITALISME ?
Il serait étonnant que la crise débouche sur une explosion du système capitaliste. Par contre, on ne peut nier la débâcle profonde du néolibéralisme et la mise à mal des dogmes du néolibéralisme utilisés au cours des 20 dernières années. La crise peut offrir de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives d’organisation, des opportunités extrêmement intéressantes aux personnes exploitées, dominées et marginalisées. Washington pourrait avoir plus de difficultés à dicter ses politiques économiques aux pays pauvres. Le modèle d’intervention économique imposée par Washington à la plupart des pays du Sud, le modèle politique économique, le modèle des relations entre l’État et la société seront profondément remis en question. On a senti d’ailleurs, lors de la réunion des chefs d’États ibéro-américains au Salvador en octobre 2008 un rejet marqué du capitalisme et de la financiarisation, ce qui marque un tournant.
Il serait souhaitable que la classe ouvrière américaine enclenche un processus de rattrapage du pouvoir d’achat perdu au cours des 20 dernières années. Ce changement pourrait donner lieu à des renversements décisifs au niveau des rapports de force, à condition de tenter de dépasser le système capitaliste. Pour la création d’un tel système social, il faudra des outils institutionnels nouveaux, des luttes énergiques, des alliances nouvelles. Les possibilités sont donc vastes et permettront peut-être de constater que le système capitaliste est toxique et destructif. Mais la crise annonce aussi certains dangers. Si le taux de chômage est élevé, que la récession est importante et que le pouvoir d’achat s’est effondré, si les masses sont désespérées et désorganisées, elles seront alors plus susceptibles de se rallier à un discours fasciste, comme ce fut le cas dans les années 40.
À QUELS MODÈLES DE CAPITALISME FAUT-IL S’ATTENDRE?
On risque de voir surgir un modèle de néolibéralisme révisé qui conserva les privilèges accordés aux capitalistes. Si tel est le cas, cela suscitera à nouveau des mécontentements et donnera naissance à de nouveaux mouvements sociaux qui lutteront à leur tour pour essayer de changer la situation de façon substantielle. Mais il est encore trop tôt pour voir apparaître un système social avec un État qui réduirait les écarts sociaux, qui investirait massivement dans les secteurs stratégiques, un État assuranciel. Les forces actuelles ne sont pas prêtes à appliquer le néo-keynésianisme.
EFFETS DE LA CRISE SUR HAÏTI
Cette crise aura des répercussions catastrophiques sur Haïti. Il y aura un ralentissement des flux de transferts de la Diaspora, des transferts évalués annuellement à 1,6 milliards de dollars américains, et qui maintiennent en ce moment l’équilibre fragile des comptes nationaux et des agrégats macro-économiques. Au cours des deux premières semaines du mois d’octobre 2008, une des institutions qui reçoivent les transferts au Cap-Haïtien a connu un ralentissement des transferts de 25 à 30%. Le pouvoir d’achat des populations a chuté, le salaire minimum déjà dérisoire est resté inchangé depuis 2003, le pays a été particulièrement touché par l’augmentation des prix des produits céréaliers et des produits pétroliers. À cela s’ajoutent les 4 cyclones qui ont frappé le pays. Tout cela a contribué à augmenter de façon dramatique la pauvreté en Haïti. On estime aujourd’hui que 3 millions de personnes sont dans une situation d’insécurité alimentaire, et ce chiffre demeurera inchangé d’ici l’automne 2009. La crise affectera les couches de la population les plus pauvres.
L’économie haïtienne est également extrêmement dépendante de l’économie américaine pour les exportations. S’il y a une récession aux États-Unis, on assistera au ralentissement des transferts et à une baisse des exportations. La demande au niveau de la sous-traitance et de certains produits primaires diminuera. On ne parviendra pas à réaliser les taux de croissance déjà faibles (1,5% à 2%) projetés par le gouvernement. Et si le gouvernement continue à appliquer les options néolibérales du Font Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale (BM), la déstructuration de l’économie nationale se poursuivra de même que l’effondrement de l’économie paysanne, ce qui réduira d’autant plus la marge de manœuvre existante pour résoudre les grands problèmes et les défis de la société haïtienne. Ce sera par contre l’occasion pour Haïti de renégocier la relation de dépendance qui la lie aux États-Unis en développant un projet national sur des bases différentes de celles qui caractérisaient le système ces trente dernières années. Ce serait l’occasion de revoir les relations entre le secteur financier et la question de production. Haïti pourrait se servir de la crise pour exiger du secteur bancaire commercial qu’une portion importante de la liquidité qu’elle détient soit affectée à des investissements productifs dans les secteurs rural et industriel. Les chiffres aujourd’hui démontrent que le crédit des banques commerciales dirigé vers le secteur rural est inférieur à 1 % du volume de crédit distribué annuellement. Et le crédit est principalement concentré autour des activités de spéculation, de change et des activités de consommation directe au niveau de la région de Port-au-Prince. Mais il n’y a pas de création d’emplois, pas de création de richesse, ni d’investissement. La Banque Centrale dispose d’instruments pour inciter les banques commerciales à investir dans le secteur de l’économie réelle pour créer des emplois.
Haïti doit reprendre le contrôle par rapport à l’orientation des politiques économiques. Cela doit se faire entre autres en intégrant des mécanismes au niveau du Parlement haïtien afin qu’il puisse surveiller le mode de gestion qui est fait avec les réserves nationales. Cela empêcherait par exemple qu’une partie des 197 millions de dollars américains débloqués pour faire face aux urgences post-cycloniques ne soit retenue par les marchés financiers américains sans que le Parlement haïtien n’ait son mot à dire, comme ce fut le cas récemment. Cela permettrait de favoriser un retour de l’ensemble de capitaux devant être investi dans l’économie nationale et de supporter les agents économiques dans le secteur rural qui n’ont pas accès au crédit bancaire.
PENSEZ-VOUS QUE CES PRESSIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES POURRONT DÉBOUCHER SUR UNE RÉACTION POLITIQUE?
Il existe un manque énorme de coordination entre ce que le gouvernement haïtien alloue pour les problèmes d’urgence et ce qui provient de l’extérieur. Il est certain que l’effondrement se poursuivra et que les niveaux de misère et de désespoir s’aggraveront tant que les mêmes politiques de néolibéralisme imposées par Washington et par les institutions financières internationales se maintiendront. La contestation sociale prendra de l’ampleur. Déjà en 2008 une contestation sociale s’est exprimée contre les politiques néolibérales du gouvernement Alexis et contre la présence de la Minustah (Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti). Si les forces sociales parviennent à s’unir dans la contestation autour de projets intelligents et d’une vision globale, alors des alternatives pourraient voir le jour. Mais nous n’en sommes pas là aujourd’hui, car le mouvement social est encore très divisé et polarisé, même si plusieurs démarches intéressantes voient le jour, notamment dans le mouvement paysan. On commence à voir des démarches qui mèneront peut-être à une unité des mouvements sociaux assez forte pour proposer des alternatives et apporter des modifications à la politique économique actuelle.
EFFACEMENT DE LA DETTE EXTERNE D’HAÏTI
Les réponses fournies par la Banque Mondiale et par le Font Monétaire International à l’égard de la dette sont insuffisantes. En mars 2006, Haïti a été intégré au programme des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE). La Banque Mondiale a reconnu à ce moment là que la dette haïtienne était insolvable, mais la réponse reste insuffisante. Les évaluations qui ont été faites, les réductions et les allègements de la dette consentis dans le cadre du programme des pays pauvres très endettés sont insignifiants et insuffisants pour libérer le pays de la domination de dette. On parlait aux dernières négociations d’une réduction de 23 millions de dollars américains du service de la dette. Lors des négociations avec le Club de Paris en décembre 2006 on a réaménagé une partie de la dette. Certains pays dont l’Espagne ont consenti à des annulations partielles de la dette et des rééchelonnements ont été effectués. Mais entre 2005 et octobre 2008, le montant du stock de la dette est passé de 1.3 milliards de dollars à 1.85 milliards, ce qui prouve que les allègements et les réductions promis n’ont aucun impact significatif sur la dette. La dette a même augmenté à un rythme plus important au cours des 3 dernières années qu’au cours des 10 années précédentes. Cela prouve que le problème de la dette reste entier. Haïti a du payer un service de la dette de 90 millions de dollars en 2007 alors qu’il s’agit du pays le plus pauvre de l’Amérique et que les ressources générées par l’État devraient être consacrées en priorité aux urgences et aux crises auxquelles est confronté le pays, tel que la question de l’alphabétisation, de la reforestation, de la restructuration du système national de santé publique, du système d’éducation national, privatisé à 82%. Cet argent devrait être consacré à des investissements significatifs au niveau des grands programmes de redressement national. Il est inconcevable que la Banque Mondiale n’ait pris aucune décision sur le chemin de l’annulation de la dette alors qu’Haïti fait face à des crises répétées qui ont plongé la population dans une pauvreté de masse. La BM a voulu faire croire à l’annulation de 500 millions de dollars mais il n’en est rien puisque les 600 millions de dollars qu’elle réclame figurent toujours au tableau de la dette haïtienne. Cette dette sert à dominer Haïti dans la mesure où elle est utilisée comme argument par les bailleurs de fonds pour exiger au pays l’exécution d’un ensemble de politiques. Le programme de PPTE est trompeur et ne vise qu’à renforcer la dépendance d’Haïti. Quelles sont les conditions qu’Haïti n’a pas respectées pour justifier le report de l’annulation de la dette à juin 2009? Ces conditions, ce sont la privatisation d’un ensemble d’entreprises publiques, notamment la TELECO et l’EDH.
EST-IL VRAI QUE LES TECHNOCRATES HAÏTIENS, SOUS LE GOUVERNEMENT ALEXANDRE/LATORTUE N’ÉTAIENT PAS EN MESURE DE CRÉER DES PROJETS CAPABLES D’ABSORBER L’AIDE ÉTRANGÈRE DE 1 MILLIARD 300 MILLIONS DE DOLLARS?
Le concept d’absorption d’aide est une mystification. Les programmes d’aide débloqués en faveur d’Haïti sont des montants marginaux compte tenu des problèmes auxquels fait face le pays. Il faudrait des investissements massifs de plusieurs milliards de dollars américains étalés sur plusieurs années pour résoudre les problèmes du pays. Par ailleurs, les fonds débloqués sont toujours décaissés trop tard, sous un ensemble de conditions qui favorisent inutilement la dispersion des interventions. La dispersion de l’aide est d’ailleurs terrible en Haïti. On dénombre 4 000 ONG dans le pays dont moins de 450 sont reconnues par le ministère de la coopération externe. Chaque bailleur de fonds exige que 80 à 90% des fonds passent par des mécanismes parallèles. Les fonds décaissés sont généralement liés à la consommation de biens provenant des pays qui ont octroyé l’aide. Haïti doit souvent avoir recours aux cadres techniques et aux experts de ces mêmes pays, ce qui ne permet pas au pays d’investir dans le cadre d’une vision nationale de développement. Les cadres haïtiens compétents ne sont pas utilisés et restent au chômage. On n’utilise pas non plus les ressources humaines qui existent au niveau de la Diaspora. Les fonds octroyés ne permettent pas non plus à l’État de contrôler l’harmonisation des interventions qui se font. Les bailleurs de fonds ont eux-mêmes reconnu lors de la réunion du Club de Paris en 2005 la faiblesse et l’incohérence des mécanismes d’aide. La question d’absorption n’est qu’un prétexte pour justifier la fausse générosité des bailleurs de fonds. Mais les prêts octroyés génèrent parfois un flux négatif de capitaux d’Haïti vers l’extérieur. Par exemple, Haïti a du payer plus de service de la dette que le pays n’a reçu de prêt de la Banque Mondiale. Notons également que la Minustah dépense 560 millions de dollars américains pour le maintien de ses troupes en Haïti alors que cet argent devrait être investi pour restructurer les institutions et pour permettre un relèvement national.
Haïti doit maintenant imaginer un projet national de développement en concertation avec le plus grand nombre d’acteurs possibles à l’intérieur du pays pour s’attaquer aux vrais problèmes, et ce, à travers des leviers tels que l’alphabétisation, la reforestation, la santé et l’éducation. Il faudra pour ce faire mobiliser toutes les énergies tant à l’intérieur d’Haïti qu’à l’extérieur, car les acteurs externes sont coresponsables de la situation actuelle et devront participer au débat, sans pour autant le diriger.
PROPORTION DU MARCHÉ HAÏTIEN DOMINÉ PAR LES DOMINICAINS
La frontière entre Haïti et la République Dominicaine est une vraie passoire. On ne connaît pas avec précision les flux de marchandises qui circulent entre les deux pays. Haïti exporte des biens agricoles vers la République Dominicaine, et cette dernière vend des produits industriels et des biens de consommation à son voisin. On parle d’une importation annuelle de 350 millions de dollars américains même si depuis un an et demi on note un ralentissement de l’importation de poulet et d’œufs suite à certaines décisions prises par le ministère de l’agriculture. Le marché clandestin et la corruption au niveau de la douane dominicaine sont importants. Mais la question encore plus préoccupante est celle de la migration. On estime qu’entre 700 et 800 mille haïtiens travaillent en République Dominicaine, et contribuent à la richesse de l’économie dominicaine de façon substantielle. Plus de 80% du travail effectué dans le secteur agricole dominicain est attribuable aux travailleurs haïtiens. Or cette contribution reste invisible parce que les droits de ces travailleurs sont bafoués en raison de leur condition de migration, de la non-intervention de l’État haïtien dans la défense de leurs droits, de certains mécanismes de discrimination et de marginalisation qui ont cours en République Dominicaine. Les travailleurs haïtiens sont traités comme des semi esclaves et reçoivent des salaires très bas. L’armée en République Dominicaine mène une répression sauvage contres ces travailleurs haïtiens qui œuvrent dans le domaine de la construction, du tourisme, de la sous-traitance. À ce jour, l’État haïtien et l’État dominicain n’ont toujours pas entamé de négociation sérieuse sur la question migratoire.