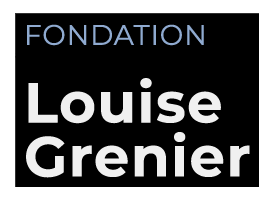Nos solidarités dans la tourmente des violences de l’extrême-droite
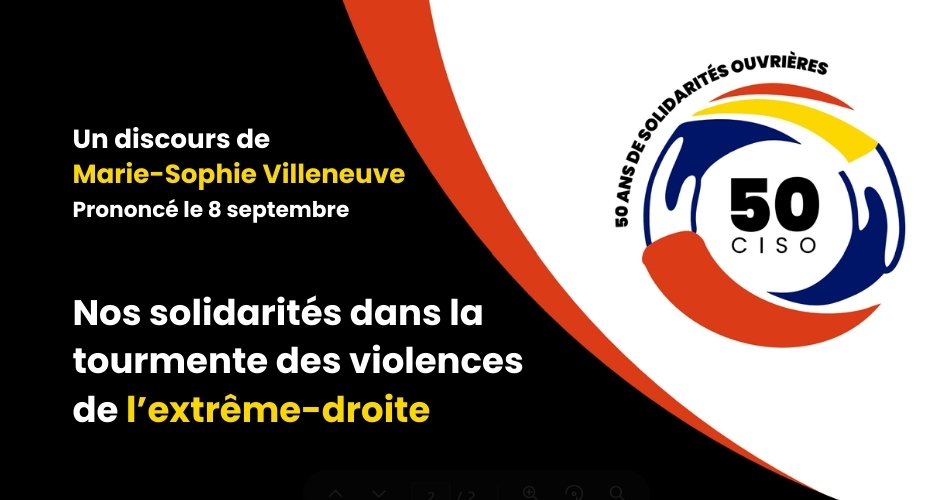
Lors de notre assemblée générale annuelle, qui s’est tenue le 8 septembre dernier, Marie-Sophie Villeneuve, membre du Conseil d’administration du CISO, s’est exprimée sur l’état de la démocratie et la montée de l’extrême droite partout sur la planète. Le texte qui suit est tiré de son discours à l’occasion de cet évènement.
Nos solidarités dans la tourmente des violences de l’extrême-droite
Le bon vieux fond raciste et colonial sur lequel nos civilisations occidentales et l’ordre mondiale se sont érigées est demeuré, somme toute, un terreau bien vivant. Alors que nos modes de vie reposent encore sur l’exploitation des ressources et de la force de travail des peuples du Sud global, l’extrême-droite fait un retour en force à la tête de plusieurs États en jouant de sa rhétorique classique – l’Autre et les contre-pouvoirs comme menaces existentielles à la Nation.
C’est un « retour vers le futur » bien funeste qui s’est joué devant nos yeux cette année : le 29 janvier dernier, deux jours après la commémoration de la libération d’Auschwitz et pendant qu’ici nous soulignions le tragique anniversaire de la tuerie islamophobe au Centre Culturel Islamique de Québec (CCIQ), Donald Trump a décrété l’ouverture d’un camp de déportation et de détention à Guantanamo, avec l’intention d’y expulser des dizaines de milliers de personnes migrantes. Puis, un accord avec le Salvador a permis de concrétiser plus rapidement le projet. C’est ainsi que les images de l’horreur ont commencé à défiler sur nos écrans : arrestations arbitraires en pleine rue par des groupuscules cagoulés à la solde du mouvement MAGA et des files d’êtres humains emprisonnés, enchaînés et dépouillés de leur humanité, entassés les uns contre les autres sur le sol froid de la prison. Et la sombre police de l’immigration bat maintenant des records : le nombre de personnes interpellées par les agents d’ICE a augmenté de 268 % cette année (comparé à 2024), pour atteindre la moyenne de 1 000 par jour cet été .
Pour citer notre collègue Mouloud Idir :
« La relative indifférence politique et médiatique autour de ces vies de personnes perçues comme excédentaires, et dont on dispose comme des variables d’ajustement, est tout aussi inquiétante. »
C’est la même indifférence politique qui regarde le génocide du peuple palestinien se déployer en direct, depuis près de deux ans maintenant. Trop peu, trop tard, des gouvernements y vont de déclarations d’appui à l’État de la Palestine, mais qu’est-ce que la Palestine sans son peuple?
Permettons-nous de regarder les courants de fonds que sont le retour en force de l’extrême-droite, des gouvernements autoritaires et des violences contre les minorités et les populations. Mais à la différence des années 1930, nous sommes aujourd’hui dans le contexte d’une économie capitaliste hautement mondialisée et d’une concentration de la richesse et du pouvoir de l’information inégalée dans l’Histoire.
La démocratie au niveau mondial
Tous les indicateurs le démontrent : la démocratie recule au niveau mondial depuis 10 ans . Selon le plus récent rapport de l’Indice de démocratie dans le monde, seulement 25 pays sont encore considérés comme des démocraties complètes, représentant 15 % de la population mondiale. À l’opposé du spectre, on compte désormais 60 pays à régime autoritaire, regroupant 36 % de la population mondiale .
L’autre facette de la médaille : les violences armées connaissent une hausse très marquée sur la planète, aussi depuis près d’une décennie . Les deux phénomènes vont de pair. En effet, les violences armées sont une cause et une conséquence des reculs de la démocratie, car l’histoire l’a maintes fois démontrée : les gouvernements autoritaires ont besoin de la guerre pour s’ériger et se maintenir.
Ces reculs s’accélèrent sous l’effet d’une vague prenant constamment de l’ampleur aux quatre coins du monde : le soutien populaire grandissant à des leaders politiques bien ancrés dans tradition du pouvoir machiste et anti-droits, affichant une aversion ouverte à l’égard des contre-pouvoirs, des sciences, de la diversité et de l’inclusion en particulier et de l’état de droit en général. Les minorités culturelles et de genre sont particulièrement dans la mire, mais les droits des travailleurs et les travailleuses ainsi que l’action des mouvements ouvriers sont aussi remis en question sur plusieurs fronts.
L’extrême-droite a ainsi fait des percées significatives en Allemagne, au Brésil, au Chili, en Colombie, en Finlande, au Japon, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, notamment. Elle s’est hissée à la tête de l’État en Argentine, en Équateur, en Hongrie, en Inde, en Italie et au Salvador, pour ne nommer que ceux-ci.
Aux États-Unis
Aux États-Unis, le phénomène est en train de se concrétiser de façon particulièrement spectaculaire : soutenue par d’immenses fortunes et des moyens de communication à portée gigantesque, la mouvance d’extrême droite dirigée par Donald Trump a réussi à revenir à la tête du Parti républicain, puis de la Maison-Blanche, afin d’implanter son programme résolument autoritaire.
Outre d’attiser la haine et d’user de répression, la méthode employée pour démanteler la démocratie américaine a été nommée « choc et stupeur » par son principal stratège, Steve Bannon : il s’agit de noyer l’appareil d’État, les oppositions politiques, les contre-pouvoirs et les médias de décisions et de déclarations chocs, notamment afin de tester et de repousser les limites du système. À l’échelle locale, particulièrement dans les États démocrates, les militants maga déploient plusieurs stratégies, dont le harcèlement et l’intimidation, contre les journalistes et les pouvoirs locaux.
Enfin, des stratégies de contrôle de l’information sont déployées au plus haut niveau, comme c’est le cas pour tous les pouvoirs autoritaires : usage du mensonge pur et simple sur une plateforme entièrement contrôlée par le président, déploiement de la censure et restrictions d’accès aux médias et aux journalistes indépendants du pouvoir politique. De manière fort pernicieuse, on accepte d’être couvert par des personnalités issues des réseaux sociaux (influenceurs) favorables au parti et qui ne sont soumises à aucune réglementation journalistique.
L’une des premières victimes de ce tournant autoritaire fut, malheureusement sans surprise, la solidarité internationale : le président s’est empressé, dès son retour au pouvoir, de couper presque l’entièreté du budget de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Et c’est sous nos yeux impuissants que l’Agence a formellement cessé d’exister, le 1er juillet dernier, après 60 ans d’activités. On estime que plus de 14 millions de personnes vulnérables perdront la vie suivant cette décision, dont un tiers d’enfants.
Au-delà de la conjoncture, une analyse de la structure s’impose. L’artiste d’origine québécoise Melissa Auf der Maur, aussi citoyenne américaine, illustre les racines du phénomène de façon limpide :
« Je reviens toujours à ma plus grande critique : le renforcement absolu des grandes entreprises aux États-Unis fait que les riches s’enrichissent, tandis que les pauvres s’appauvrissent. »
Les intérêts des entreprises et la promotion du consumérisme ont conduit à une grande crise sur la planète et dans le monde politique aujourd’hui. Un arrêt de la Cour suprême adopté en 2010 a supprimé les limites du financement des campagnes politiques par les entreprises. C’est hors de contrôle, et nous, le peuple, avons perdu le contrôle. Une réforme du financement des campagnes électorales est urgente, pour empêcher qu’un parti politique soit acheté par des intérêts privés.
Car, oui, on peut acheter des votes ici, et il semble pour l’instant que le parti qui prend le contrôle de la Maison-Blanche ce lundi (20 janvier 2025) est, manifestement, le parti des milliardaires.
Nous sommes entrés dans une nouvelle ère où la colère et le fait de dresser les gens les uns contre les autres, avec l’aide des réseaux sociaux et de la désinformation, ont pris le dessus .
On en revient donc au bon vieux pouvoir de l’argent, cette fois-ci conjugué avec le nouveau pouvoir immense du numérique. Jusqu’où l’extrême-droite trumpiste réussira-t-elle à faire reculer la démocratie états-unienne? La réponse reste entièrement à venir.
Au Canada et au Québec
Le Canada et le Québec ne sont pas à l’abri de ces forts vents de droite, au contraire. Tant au fédéral que dans les provinces, des personnalités politiques bien en vue jouent abondamment de la rhétorique présentant l’Autre et les contre-pouvoirs, dont les milieux syndicaux et progressistes, comme la grande menace existentielle à la Nation.
Globalement, un processus d’effritement démocratique est aussi observé ici depuis quelques années déjà : alors que le Canada avait coutume de figurer dans les cinq pays les plus démocratiques au monde, l’Indice de démocratie canadien a chuté en 2021 et le pays est passé, cette année-là, de la 5e position à la 12e position, puis à la 13e position en 2023 et à la 14e position en 2024. De jamais vu depuis les débuts de l’indicateur.
Selon les analyses, ce recul navigue sur des courants similaires à ce que l’on voit aux États-Unis, mais ils demeurent propres aux spécificités sociales, politiques et économiques du Canada et du Québec.
La diminution de l’adhésion populaire à la démocratie
D’abord, la même tendance culturelle s’observe ici, surtout depuis la pandémie : la part des personnes qui ne croient plus en la démocratie comme forme d’organisation politique la plus légitime augmente constamment. Et moins la population croit en la démocratie comme étant le meilleur système politique, plus grandes sont les probabilités qu’elle soutienne un leader à saveur autoritaire.
Les difficultés socioéconomiques vécues par une part grandissante des ménages (inflation, risques de perte d’emploi, crise du logement, etc.) sont, ici comme aux États-Unis, au cœur de l’enjeu. Cela nous ramène immanquablement à l’égalité des chances, à nos services publics et parapublics, au filet social et à nos solidarités. Or, ceux-ci sont sévèrement mis à mal par des décennies de politiques néolibérales, qui se déploient encore actuellement avec beaucoup de vigueur : réformes déstructurantes et austérité budgétaire, alors que les besoins et les défis auxquels nous devons répondre augmentent constamment.
Remises en question de l’égalité et des droits
Ensuite, les discours et les projets de loi remettant en question l’égalité et les droits se font beaucoup plus présents au Canada et au Québec depuis quelques années, en particulier contre les personnes immigrantes précaires, les minorités culturelles, les femmes, les personnes de la diversité sexuelle et de genre, les membres des communautés autochtones ainsi que les travailleuses et travailleurs et leurs syndicats.
Enfin, la richesse du privé passe encore avant la richesse des communautés
Les solutions politiques préconisées pour résoudre les importantes crises, comme celle du logement ou de la guerre commerciale, mettent toutes l’accent sur les investissements et le soutien à la croissance des secteurs traditionnellement masculins (complexe militaro-industriel, industrie de la construction et des infrastructures, exploitation des ressources naturelles et minières, etc.).
Pendant ce temps, la précarité structurelle dans les secteurs économiques des emplois majoritairement occupés par les femmes et les personnes immigrantes demeure toujours dans l’ombre, tout comme les inégalités structurelles vécues par les populations du Sud global. Pire, les ressources investies dans ces secteurs ne sont toujours pas perçues comme des investissements, mais comme des dépenses et des fardeaux budgétaires, notamment en éducation, en santé, en action communautaire et en solidarité internationale. La valeur générée par le travail dans ces secteurs n’est pas absolument pas reconnue. Elle est pourtant garante de la richesse des communautés.
Conclusion
En guise de conclusion et d’ouverture, soulignons que les mouvements sociaux, ouvriers et communautaires sont déjà positionnés pour être au cœur de la solution.
• Ils jouent un rôle central dans les luttes contre la précarité socioéconomique.
• Ils sont un pilier essentiel de la démocratie représentative.
• Ils offrent des espaces pour se rassembler, réfléchir, s’informer, échanger et agir sur les enjeux de société.
À cet égard, le repli sur soi et sur ses seules préoccupations est le pire choix possible. La solidarité internationale est plus que jamais un nécessité, car la profonde crise du système qui nous affecte, tant dans nos vies quotidiennes que dans nos organisations, trouve ses racines dans l’ordre international actuel.
Ça tombe bien, car nous avons un outil unique au Québec pour cette solidarité : le CISO et ses 50 ans de solidarités ouvrières internationales!
Longue vie au CISO!
Marie-Sophie Villeneuve, membre du Conseil d’administration du CISO