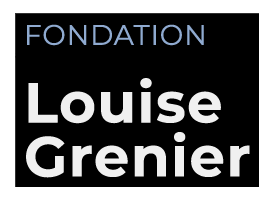Article dans Le Devoir: «Ennemie de l’État», amie des ouvriers

Marco Fortier
Marco Fortier, publié le 11 avril 2016
Le pire désastre industriel de l’histoire du Bangladesh a frappé le 24 avril 2013, quand le Rana Plaza, un bâtiment de huit étages, s’est effondré comme un château de cartes. Plus de 1100 travailleurs du textile, en majorité des femmes, ont péri dans la tragédie. Trois ans plus tard, les conditions de travail se sont améliorées. Mais les ouvriers n’ont pas le coeur à la fête.
« Grâce à la solidarité internationale, nous avons eu un accord qui promet davantage de sûreté dans les usines de textile, mais il y a encore du chemin à faire », dit Kalpona Akter, une militante pour les droits des travailleurs établie à Dacca, capitale du Bangladesh.
Elle est toute menue, Kalpona Akter. Mais elle a une grande influence dans ce pays où 4 millions des 150 millions d’habitants gagnent leur vie grâce à l’industrie du textile. Elle dérange les riches et puissants : en 2010, elle a été arrêtée, détenue et décrite comme une « ennemie de l’État » après de violentes manifestations pour les droits des ouvriers. Le Devoir l’a rencontrée dans un hôtel du centre-ville de Montréal la semaine dernière où elle donnait une conférence à l’invitation d’ONG et de syndicats.
Cette militante de 39 ans dirige le Centre de solidarité des travailleurs du Bangladesh (Bangladesh Center for Worker Solidarity). Kalpona Akter sait de quoi elle parle : elle a elle-même travaillé dans une usine de textile à l’âge de 12 ans, quand son père est tombé malade.
Les conditions de travail l’ont vite révoltée. Salaire abominable de 6 $ par mois pour 450 heures de travail, aucune journée de congé, absence d’eau potable sur les lieux de travail, nombre effarant d’accidents à l’usine… À 15 ans, elle avait fondé une sorte de syndicat non officiel dans le sweatshop où elle travaillait.
Un an plus tard, sa réputation de fautrice de troubles l’a menée au congédiement. Elle en a profité pour divorcer du contremaître de l’usine avec lequel elle avait été mariée plus ou moins contre son gré, neuf mois plus tôt. « Il me maltraitait. Je suis partie », raconte-t-elle dans un bon anglais.
Des progrès douloureux
Depuis, les droits des ouvriers du textile du Bangladesh ont progressé à petits pas, estime Mme Akter. Mais il a fallu une série de tragédies pour éveiller les consciences.
Par exemple, les portes du Rana Plaza étaient verrouillées quand l’immeuble qui hébergeait plusieurs ateliers de vêtements s’est effondré, le 24 avril 2013. La veille, des employés avaient rapporté la présence de larges fissures dans les murs du bâtiment, dont trois étages auraient été ajoutés sans permis.
Le patron de l’usine et propriétaire du bâtiment, Sohel Rana, avait ordonné aux travailleurs de rentrer au travail malgré les craintes pour la stabilité de l’édifice. L’homme d’affaires et 40 autres personnes ont été accusés de meurtre et de négligence criminelle, à la fin de l’année 2015.
« Avant, la vie d’un travailleur valait moins qu’un t-shirt. Ça change. Les employés savent qu’ils sont là pour travailler, et non pour y laisser leur peau, dit Kalpona Akter. Maintenant, les travailleurs se plaignent immédiatement s’ils voient une porte verrouillée ou s’ils constatent qu’un mur craque à cause d’un vice de construction. Et ils sortent s’ils ne se sentent pas en sécurité. »
Signe des temps, plus de 200 grandes marques de vêtements ont signé un accord qui prévoit un renforcement des normes de construction, une meilleure protection contre les incendies et une série d’autres mécanismes favorables aux travailleurs. Le nombre de morts d’ouvriers du textile a chuté de façon considérable au pays, passant de 200 à 10 par année en trois ans, souligne Kalpona Akter.
Pour des achats responsables
Des travailleurs ont manifesté la semaine dernière à Dacca pour demander que le salaire minimum double à 128 $ par mois. Les ouvriers ont moins peur qu’auparavant de défendre leurs droits : près de 500 syndicats ont été créés dans le textile depuis trois ans. L’envers de la médaille, c’est qu’à peine 40 d’entre eux sont assez forts pour avoir signé une convention collective, explique Mme Akter.
« Les propriétaires d’usine sont très puissants. Ils ont des liens étroits avec le gouvernement. Plusieurs sont des législateurs qui siègent au Parlement », affirme-t-elle.
« Depuis 100 ans, les travailleurs ont appris les lois et à faire respecter leurs droits, mais les grandes entreprises ne se sont pas civilisées. Chaque fois que des travailleurs se battent pour leurs droits, les entreprises ferment leurs usines et les déménagent dans des États où les employés ont moins de droits. Les usines du Canada et des États-Unis ont déménagé au Mexique et au Honduras, puis en Europe, et maintenant en Asie. Les multinationales bougent sans cesse, mais n’ont jamais introduit l’éthique dans leurs affaires, sauf quand elles y ont été forcées », ajoute la militante.
On aimerait bien acheter des vêtements « éthiques », mais comment s’assurer que la jolie chemise ou les pantalons qu’on trouve sur les tablettes n’ont pas été produits par des femmes ou des enfants sous-payés et maltraités ?
« Achetez vos vêtements dans n’importe quel magasin, mais comportez-vous en consommateur responsable. Vous avez un pouvoir en tant que consommateur. Posez des questions aux vendeurs, aux gérants et aux chaînes de détaillants, demandez-leur d’où viennent leurs produits et dans quelles conditions ils ont été fabriqués. Demandez-leur le salaire des travailleurs d’usine, demandez si les travailleurs ont le droit de se syndiquer », dit Kalpona Akter.
Chose certaine, « le boycottage des produits fabriqués au Bangladesh n’est pas une solution. Le textile emploie 4,2 millions de personnes, dont 85 % sont de jeunes femmes. Ça leur donne du pouvoir sur leur vie », estime-t-elle.
Le gouvernement du Canada peut aussi apporter sa contribution : un accord signé en 2003 permet au Bangladesh, un des pays les plus pauvres de la planète, d’exporter au Canada sans frais de douanes. Aucune clause n’oblige pourtant les entreprises du Bangladesh à respecter leurs travailleurs pour jouir de cet avantage compétitif. Ottawa pourrait facilement mettre de la pression pour le respect des droits des ouvriers, fait valoir Kalpona Akter. Invitée à Ottawa, elle compte bien faire passer son message à Justin Trudeau.