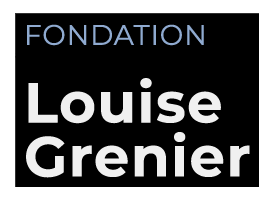D’hier à aujourd’hui : la CDPQ face à l’apartheid

Félix Beauchemin, avec la collaboration d’Amélie Nguyen
Au milieu des années 1980, dans la foulée des sanctions économiques imposées en Afrique du Sud, un débat spécifique secoue le Québec : la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) devrait-elle continuer d’investir dans des entreprises complices de l’apartheid qui y sévissait? Syndicats, organismes populaires, mouvements de solidarité internationale et figures religieuses ont alors fait monter la pression, exigeant que les fonds publics du Québec cessent de soutenir un régime fondé sur la ségrégation raciale et la violence coloniale.
Quarante ans plus tard, la question refait surface. Cette fois, c’est la complicité de la CDPQ avec l’apartheid, la colonisation, l’occupation et le génocide imposé au peuple palestinien qui est au centre des critiques. Analysons l’historique des deux campagnes.
Les années 1980 : une mobilisation importante
En 1983, des articles de presse révèlent que la CDPQ détient des investissements dans onze entreprises canadiennes (pour la plupart, minières) œuvrant en Afrique australe. Celle-ci contribue ainsi, aux dires du journaliste André Dionne, « directement au maintien de l’ordre financier et politique du régime d’apartheid d’Afrique du Sud ».
Le scandale prend rapidement de l’ampleur. En 1985, la CSN publie un rapport accablant qui dénonce la complicité de la Caisse : ce sont 2 milliards $ qu’investit la CDPQ en Afrique du Sud, dont 600 millions $ en investissements directs. Parmi ceux-ci, on retrouve des entreprises extractivistes encore actives comme Alcan, Coal India et Moore Global. Le chroniqueur Jean-Claude Leclerc du Devoir dénonce alors une CDPQ qui « consolide, pour une part qui n’est jamais négligeable, l’oppression raciale et l’exploitation économique de la majorité noire ». Et d’ajouter, avec ironie, que la Caisse, censée « renverser au Québec ce genre d’injustice historique », devient complice de l’appauvrissement ailleurs. Un parallèle particulièrement pertinent!
La mobilisation contre la CDPQ devient alors centrale au mouvement de désinvestissement. Le 21 mars 1986, l’entreprise Alcan annonce son départ de l’Afrique du Sud, un geste salué comme une victoire partielle du mouvement. Mais la CDPQ, elle, refuse de suivre, citant son refus « d’abstention, de retrait ou de toute autre abdication de responsabilité » envers l’Afrique du Sud. Elle maintient sa conviction que « les entreprises dans lesquelles elle investit “agissent comme de bons citoyens et procurent de justes retombées économiques”, notamment “par une gestion des ressources humaines qui respecte et reflète la population concernée par les activités de l’entreprise” ».
Cette posture est de plus en plus intenable. En juin 1986, l’archevêque Desmond Tutu, figure emblématique de la lutte anti-apartheid, est reçu à Montréal pour une tournée d’événements d’envergure. Ironie du sort, certains de ces événements sont financés par la CDPQ elle-même. Tutu appelle alors directement le gouvernement québécois et la CDPQ à cesser leurs investissements. Tel que le relate Le Devoir, « la principale question à laquelle devait répondre le premier ministre du Québec, M. Robert Bourassa, au sortir de son entretien avec le prélat sud-africain, touchera les activités de la [CDPQ]. » Bourassa promet alors de « regarder de près » la situation, pendant que syndicats et coalitions citoyennes, eux, multiplient campagnes et lettres ouvertes.
La CDPQ ne plie pas publiquement, mais l’histoire nous montre que la multiplication des pressions, boycottages et sanctions finit par isoler économiquement l’Afrique du Sud, rendant le régime insoutenable. Si les institutions refusent de l’admettre, le retrait progressif d’entreprises comme Alcan démontre que les investisseurs ont bel et bien un pouvoir de changement. À cet effet, le ministre des Finances de l’époque, Gérard D. Lévesque, admet que le président de la Caisse a un pouvoir de dissuasion au sein des entreprises complices dans laquelle elle investit, allant même jusqu’à avouer que l’organisation a eu une part de responsabilité, en tant qu’actionnaire important, dans la décision d’Alcan de se retirer de l’Afrique du Sud. Quant à eux, les syndicats – et bien que ces décisions puissent toucher des secteurs qui emploient beaucoup de travailleurs et travailleuses – n’ont pas hésité à faire pression en faveur d’un désinvestissement. Le cas des Travailleurs canadiens de l’automobile (Unifor–FTQ) et du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (FTQ), alors mobilisés dans leur milieu de travail autour de principes fondamentaux de solidarité internationale, a joué un rôle majeur dans les campagnes de sanctions.
2022-2025 : le cas palestinien
Aujourd’hui, le paysage social a certes changé, mais l’histoire se répète. Depuis plusieurs années, des organisations comme Al Haq, B’Tselem, Amnistie internationale et Human Rights Watch qualifient la situation en Palestine d’apartheid. Colonisation continue, blocus de Gaza, ségrégation physique, politique et juridique, violences : les mécanismes rappellent étrangement ceux de l’Afrique du Sud. La situation actuelle à Gaza, quant à elle, atteint un point de non-retour : famine organisée, plus de 60 000 morts depuis octobre 2023, destructions massives et un avenir où la reconstruction paraît quasi impossible. Il est désormais admis par une commission d’enquête internationale indépendante mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU qu’un génocide y a cours.
Or, la CDPQ détient encore des placements dans des entreprises qui soutiennent ou profitent de l’occupation et de la colonisation des territoires palestiniens. Tel que le dévoile un rapport publié par la Coalition du Québec Urgence Palestine, la Caisse investit dans 76 entreprises complices, pour un total de plus de 27 milliards $, dont 3,4 milliards dans l’armement (Lockheed Martin, entre autres).
Comme dans les années 1980, syndicats, groupes de solidarité internationale et mouvements citoyens réclament un désinvestissement. Et comme à l’époque, la Caisse répond en se dédouanant de ses responsabilités, indiquant son incapacité à assurer un pouvoir sur ces décisions. Bien qu’elle « consulte des experts de renommée internationale » en droit international, et bien que la rapporteuse spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, demande le retrait d’investissements d’une économie qui « soutient Israël » dans ses objectifs, la CDPQ demeure vague quant à ses intentions, détourne l’attention de ses investissements dans des entreprises israéliennes et emploie un discours technique, sans spécifier les supposés critères de droits de la personne sur lesquels elle se base dans ce cas précis.
Pourtant, le désinvestissement est possible. La Caisse l’a déjà fait, notamment dans le tabac ou certaines énergies fossiles, qu’elle jugeait contraires aux intérêts éthiques de l’organisation et de la société québécoise. Pourquoi alors, et pas maintenant?
La Caisse a un pouvoir politique
Lorsqu’on compare les deux campagnes, les similitudes dans le discours de la Caisse sautent aux yeux. Dans les deux cas, celle-ci dit manquer de pouvoir d’agir en raison de son faible rôle dans les entreprises ciblées, insiste sur ses consultations d’« experts » en éthique et se réfugie derrière une neutralité financière prétendue. Dans les deux cas, elle se présente comme spectatrice plutôt qu’actrice, comme si ses milliards investis n’avaient ultimement aucune conséquence réelle.
Pourtant, l’histoire nous enseigne que les pressions économiques en Afrique du Sud, jumelées à d’autres sanctions étatiques, ont fonctionné. À l’époque, plus de 50% des entreprises canadiennes, australiennes et américaines avaient fini par se retirer de ce pays, souvent sous la pression de leurs investisseurs. La CDPQ a donc ici un rôle crucial pour la suite des choses. Elle peut démontrer qu’elle est capable d’utiliser son pouvoir économique important pour changer les règles du jeu; pour devenir un véhicule de justice et non d’oppression. Cette responsabilité politique prend d’autant plus de poids que la Caisse agit au nom de la collectivité québécoise.
La CDPQ, toujours dans la ligne de mire
Si la Caisse a été et demeure une cible privilégiée des critiques, ce n’est pas par acharnement. La CDPQ n’est pas un investisseur comme les autres : il s’agit d’une institution publique qui gère l’épargne collective des Québécois et des Québécoises, notamment par le biais des fonds de pension, financés par des cotisations obligatoires. Ce faisant, chaque placement controversé engage ainsi la population entière des travailleuses et travailleurs, sans qu’elle puisse se prononcer.
C’est ce statut d’« utilité publique » qui donne un poids moral particulier aux demandes de désinvestissement. Lorsqu’elle finance des régimes oppressifs, la CDPQ le fait au nom de tout le Québec. Et plus encore : elle choisit, de façon unilatérale, ce qui est jugé éthique ou acceptable aux yeux des cotisant·e·s.